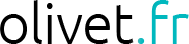Parcours patrimoine
L'Orme-Grenier
Informations annexes au site
De belles maisons de campagne
L’Orme-Grenier est un très ancien nom de lieu d’Olivet : il y avait là, dès le Moyen Age, une propriété environnée de vignes, attestée dans des actes du début du 15 e siècle, avec une maison de maître et une chapelle, dont Léon-Noël de Buzonnière dit, dans son Répertoire archéologique du Loiret (1877) « qu’on voyait naguère au-dessus de la porte un groupe de pierre du XVe représentant Notre-Dame de Pitié tenant sur ses genoux le corps de Jésus-Christ ».
Au milieu du 16 e siècle, Joachim du Moulin, sieur de l’Orme-Grenier, devenu protestant, a été l’un des tout premiers pasteurs dans notre région. Après la Saint-Barthélemy il a dû se réfugier à Bâle. Son fils Pierre, pasteur également, a été l’une des grandes figures du protestantisme sous Louis XIII. Et tout autour, ce n’étaient que champs de vignes, dont le cadastre a conservé les jolis noms, clos de Barbotte, clos d’Yvoie, clos de Villebouret, parsemés de « maisons de vignes », comprenant la maison de maître, le logement du vigneron, le pressoir, le cellier, l’écurie pour le cheval, la cour et le verger. Dans le quartier de l’Orme-Grenier, ces modestes maisons de campagne s’appelaient, au 18 e siècle, la Petite-Motte-Colombier, le Petit Chaperon-de-Bourges, la Caquerotte, le Petit-Couasnon (qui existe toujours) …
En face, de l’autre côté de la route, se trouvaient deux belles propriétés mitoyennes : Les Murs Blancs (appelée plus tard château de l’Etang, racheté et loti dès 1939 par un industriel château de l’Etang), et Larcher, dont le nom allait devenir L’Archette dans la deuxième moitié du 19 e siècle.Cette noble demeure à l’architecture classique, autrefois entourée d’un vaste parc à la française célèbre à la ronde (où serpentait un ruisseau, le Lazin), a gardé grande allure derrière sa grille en fer forgé qui ouvre sur l’avenue du Loiret à la Croix-Lazin.
En 1942 le grand domaine de l’Archette, vendu par les héritiers des derniers propriétaires, la famille de Lestrange, a été converti en Foyer des apprentis horticoles, à l’initiative des professionnels de l’horticulture d’Orléans : cet établissement privé était géré à la fois par l’Union horticole orléanaise et l’Union maraîchère orléanaise. En 1951, alors que le Foyer des apprentis horticoles a quitté Olivet et a été transféré sur Orléans rue Basse-Mouillère (c’est l’actuel Lycée privé de l’Horticulture et du Paysage d’Orléans), le Centre de formation professionnelle des adultes s’installe à L’Archette. De nombreux bâtiments ont alors été construits à l’arrière du château par l’architecte André Bezançon (architecte de la reconstruction de Châteauneuf-sur-Loire, qui avait aussi réalisé l’hôtel de Beauvoir à Olivet). Aujourd’hui l’AFPA, sur ce beau site de 5,5 hectares, propose de nombreuses formations diplômantes. Quant au château de l’Etang, démoli, il a laissé la place à l’ancienne clinique de l’Archette ouverte en novembre 1969.
Les fabriques de l’Orme-Grenier
Mais revenons à notre Orme-Grenier qui est, au début du 19 e siècle, une très jolie maison de campagne, avec son ancienne chapelle en bordure de la route, ses charmilles, ses clos de vignes et son très grand verger qui comptait près de 2000 arbres fruitiers. Ce vaste ensemble, resté encore d’un seul tenant, va, au fil de nombreux changements de mains au 19 e siècle, être scindé en plusieurs propriétés. Et l’on voit s’y installer, à partir de 1850, des « industriels », intéressés par le terrain et les bâtiments disponibles, et par la situation en bordure de la grande route impériale puis nationale N°20. Ainsi dès 1847 fonctionne à l’Orme-Grenier une fabrique d’épingles à cheveux, succursale de la grosse manufacture d’épingles d’Henri Ratisseau située à Orléans faubourg Madeleine. Ernest Badin, dans sa Géographie départementale, 1848, nous apprend que la fabrique d’épingles d’Olivet produit annuellement, en moyenne, 9500 kg d’épingles et qu’elle occupe environ 30 ouvriers. Elle reste en activité jusqu’en 1875. Tout à côté, Léopold Marchand crée en 1852 une « Fabrique de Chaussures à la mécanique », une usine pionnière unique dans le département, et l’une des premières en France à être équipée de machines modernes pour mécaniser la production de chaussures. Dès la création, le succès est au rendez-vous, Léopold Marchand forme de nombreux ouvriers et ouvrières et ouvre un magasin de vente au 74 rue Royale, qui sera transféré en 1867 au 46 rue Bannier.
L’Orme-Grenier et la Fabrique de mèches Lafaurie
C’est une belle histoire à la fois entrepreneuriale et familiale qui a duré près d’un siècle et fait partie de la mémoire d’Olivet. Tout a commencé en janvier 1881 lorsqu’Henri François Lafaurie (1837-1918) rachète à Louis Croze la fabrique de mèches pour lampes que ce dernier exploitait à Olivet 8 route de Saint-Mesmin, en face de l’église. Henri Lafaurie a travaillé auparavant pour la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest en qualité de Contrôleur chef de l’éclairage : au cours de ces années il a acquis une grande expérience dans le domaine de l’éclairage intérieur et extérieur des wagons et a mis au point plusieurs inventions.
Désireux de s’étendre, il achète en 1895 à la veuve de Wilfrid Bourdon (un chimiste qui faisait à l’Orme-Grenier des recherches scientifiques sur les alcoomètres ou dilatomètres) la propriété de l’Orme-Grenier avec l’ancienne maison de maître. Il s’y installe avec sa famille et construit sur le terrain une nouvelle usine pour sa fabrique de mèches pour lampes qui va devenir très importante, avec une douzaine de métiers à tisser actionnés par une machine à vapeur. Les mèches produites, mèches cirées, mèches suiffées, sont destinées à l’éclairage des lampes à huile, à colza, à pétrole, ainsi qu’aux fourneaux à pétrole et aux calorifères. Henri Lafaurie dote son affaire d’un siège parisien où se négocient les affaires commerciales : l’usine olivetaine fournit en mèches toutes les compagnies de chemin de fer françaises et algériennes, belges, roumaines etc.
Ses fils Georges et Charles prennent sa suite : ils agrandissent et modernisent l’usine mais Georges meurt brutalement en 1934. Avec le développement de l’électricité, la fabrique trouve de nouveaux débouchés, comme la fabrication des balais à frange sous la marque les balais Soleil (précurseurs des balais Océdar) et l’amadou des briquets. Puis elle cesse ses activités en 1972 : l’usine et le grand terrain derrière la maison cèdent la place à des immeubles, mais, côté rue de Couasnon, la noble demeure de l’Orme-Grenier existe toujours, actuellement scindée en deux habitations. Elle n’a pas changé, avec ses élégantes lucarnes et, sur la droite la partie plus ancienne, qui a conservé ses colombages côté jardin, dont la tradition voulait qu’elle remonte à Jeanne d’Arc…
Et la fabrique de mèches Lafaurie n’a pas complètement disparue puisque plusieurs métiers à tisser de l’usine d’Olivet ont été offerts à L’Atelier Musée textile de Bolbec en Normandie et retrouvent là-bas une nouvelle vie
Les Cireries d’Olivet
Toujours dans ce quartier du Val, au sud-ouest de l’Orme-Grenier, la longue rue des Cireries (entre la rue d’Ivoy et la rue de la Reine-Blanche) conserve le souvenir d’une ancienne activité, autrefois très importante et réputée : celle des blanchisseries de cire et des fabriques de cierges et de bougies. Car Olivet est resté, pendant des siècles, l’un des premiers centres en France de cette industrie très spécialisée.
Autrefois les cierges étaient confectionnés uniquement à partir de cire pure d’abeilles. Et les très nombreux ruchers de l’Orléanais fournissaient des quantités importantes de cire aux « marchands ciriers ». Comme le miel, la cire est plus ou moins colorée en fonction du type de pollen que les abeilles ont butiné. C’est pourquoi la cire brute ou cire jaune avait besoin d’être blanchie : on faisait d’abord fondre la cire des ruches dans de l’eau bouillante, dans de grandes chaudières. Puis on la laissait se solidifier en surface (on disait que la cire grêlait) pour la récupérer sous forme de petites parcelles et de grains. Alors commençait le blanchiment proprement dit qui se faisait, sur des toiles tendues à environ cinquante centimètres au-dessus du sol, en plein soleil, tout au long de la belle saison. On la laissait là jour et nuit jusqu’à ce qu’elle fût parfaitement blanchie. Puis on la faisait à nouveau fondre dans de grandes chaudières pour la mouler en « pains » de cire ou en cierges.
Ce site d’Olivet était particulièrement favorable à l’établissement de blanchisseries pour la douceur du climat, la luminosité du ciel et l’absence de vents violents. Les ciriers pouvaient également disposer de grandes prairies en pente douce et bien exposées vers le sud sur la rive droite du Loiret. Pour toutes ces raisons, ce quartier a abrité, depuis le début du 18 e siècle, plusieurs de ces fabriques, dont les bâtiments sont encore en partie visibles. Sur la rue des Cireries, qui s’appelait autrefois rue des Mulotières, s’étaient implantées deux importantes manufactures de cire : l’une se trouvait sur le côté nord de la rue (actuellement N°804), fondée en 1710 et reconnue Manufacture royale en 1750. C’était la manufacture de cires la plus importante de la Généralité, et à sa tête se sont succédé des négociants dynamiques comme les Seurrat de Guilleville, les Germon, les Sauvau qui ont maintenu l’activité jusqu’en 1932. On peut toujours voir le haut porche de pierre qui fermait l’entrée de cet établissement ; et l’on peut deviner, au-dessus de ce portail, les lettres à moitié effacées de l’inscription « Manufacture royale de Cire ». Le grand bâtiment de l’ancienne cirerie existe toujours et reste bien reconnaissable malgré les modifications (il a été divisé en plusieurs habitations).
De l’autre côté de la rue des Cireries, côté sud, (actuellement N°845, avec sa belle grille ouvragée) La Ruche, appelée aussi Saint Julien, était également un établissement très ancien, mais qui a cessé ses activités vers 1850. Le quartier comptait une autre cirerie à l’Orbellière ; et, tout au bout de la rue des Cireries, en bordure de la rue de la Reine Blanche, existait une autre manufacture analogue, plus tard remplacée par la ferme du château de la Fontaine, qui a longtemps conservé son nom « La Blanchisserie ». On peut toujours voir les beaux bâtiments de cette Ferme de la Fontaine, reconstruits au début du 19 e siècle par les d’Illiers. Enfin, Olivet a abrité, plus au sud, dans le quartier de la Fougère (près de l’actuel centre sportif du Donjon), une très importante fabrique de cire, qui, fondée en 1720, a fonctionné jusqu’au milieu du 20 e siècle : la manufacture de la Fougère, qui a connu différentes raisons sociales, Baron-Boisdron, Desforges-Baron, Chalon-Desforges. Elle a acquis une réputation universelle en raison de la qualité de la cire qu'elle livre au commerce, glanant d’innombrables médailles dans les concours et expositions nationaux et internationaux. Par exemple :
« En 1867, à l’exposition universelle de Paris, M Desforges-Baron a exposé des cires blanches et jaunes, des cierges et des bougies de toutes sortes qui par leur perfection et leur éclat attirent les regards des visiteurs. Il a également présenté des échantillons de cire sous diverses formes et à différents degrés de purification. Une médaille d’argent vient de lui être décernée. C’est une juste récompense pour une maison placée au premier rang en France comme manufacture et blanchisserie de cire. » (Journal du Loiret du 11 juillet 1867)
« En 1878 à l’Exposition universelle de Paris, nous avons remarqué de magnifiques spécimens de cire blanche et de cire jaune de M. Desforges-Baron, justement récompensé.»
La maison possédait un grand magasin de vente de ses produits, « Cires-Cierges-Bougies », place de la Croix-Morin à Orléans.
La maison fabriquait également des encaustiques sous la marque Le Verglas. Puis en 1926, Paul Chalon, qui a hérité de l’entreprise au décès de son père Fernand Chalon en 1917, s’associe avec Léon Metz et Jean Dumont. L’usine est, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l’une des plus importantes de France, blanchissant la moitié de la production de cire française.
La manufacture de toiles peintes des Jacque de Mainville
Ce fut l’un des fleurons de l’industrie orléanaise sur les bords du Loiret, à la fin du 18 e siècle : fondée à Orléans en 1762, cette manufacture de luxe fut transférée à Olivet en 1784 sur le domaine du Couasnon.
Les indiennes ou toiles d’Inde, appelées aussi « Perse », cotonnades imprimées d’abord importées d’Asie par la Compagnie des Indes, étaient très en vogue dans le royaume à partir du début du 18 e siècle. Mais la fabrication de ces « toiles peintes » étaient interdites en France pour ne pas concurrencer l’industrie nationale de la laine et de la soie : les femmes en portant étaient condamnées à des amendes. L’autorisation de les fabriquer en France ne date que de 1752. En 1759 Oberkampf installe la manufacture toile de Jouy.
Un Orléanais, l’entreprenant François Jacque, seigneur de Mainville (1712-1788) se lance à son tour dans l’aventure des toiles imprimées. Soutenu par Perrin de Cypierre, intendant de l’Orléanais, il crée en 1762 une fabrique de toiles peintes et obtient un site de choix pour établir son entreprise à Orléans : près du nouveau pont, à l’angle de la rue Royale, dans l’un des deux beaux pavillons, côté est. Grâce aux encouragements et aux aides financières de l’intendant Cypierre et à la mode des « indiennes », la fabrique fonctionne avec succès à Orléans, où elle emploie 200 ouvriers. Mainville fait venir des Hollandais coloristes, dessinateurs, graveurs pour former de bons ouvriers. Puis son fils Pierre Luc François Jacque de Mainville (1746-1803) lui succède à la tête de la manufacture qu’il développe et qu’il transfère en 1784 sur le domaine de Couasnon (acheté en 1782) en bordure du Loiret, en bas du pont d’Olivet.
Il veut utiliser les eaux du Loiret qui étaient alors exceptionnellement pures et d'une température à peu près constante, ainsi que les grands prés le long de la rivière pour étendre et blanchir les toiles. Il construit ses ateliers de part et d'autre de la cour d'honneur du château et utilise de manière optimale le Moulin du Pont. Celui-ci broyait la farine durant le jour et actionnait durant la nuit les cylindres des calandres qui glaçaient et lustraient les étoffes. Il passe pour cela un accord avec le propriétaire du moulin Fougeu d’Escures, et fait installer une deuxième roue sur l’autre côté du moulin : ainsi le meunier pouvait-il continuer à moudre les grains le jour, tandis que la nuit, de l’autre côté, fonctionnaient les machines à calandrer les toiles.
L’usine fonctionne à plein et fabrique 16 000 pièces par an avec une quarantaine de métiers, employant plusieurs centaines d’ouvriers. Les toiles de fil et de coton blanches venaient de Suisse et d’Inde, et l’on en faisait des tissus imprimés pour les vêtements, pour l’ameublement ainsi que des mouchoirs, « mouchoirs d’indiennes, des mouchoirs de fil façon des Indes, et ceux imitant les mouchoirs de Masulipatam ».
Ces « chefs de pièce » comme on les appelle, sont imprimés sur l’envers de la toile avec un N° et la mention : « Toile bon teint de la manufacture de Jacque de Mainville à Orléans ». Un édit royal faisait en effet obligation d’imprimer la marque sur chaque pièce de tissu des indiennes. Luc François Jacque de Mainville entreprend alors de transformer et agrandir sa demeure du Couasnon en 1798, l’ornant côté sud d’une élégante rotonde à colonnades néo-classique. Il avait auparavant racheté le domaine des Quatre-Vents, sur Olivet, au sud du bourg, où il avait développé, pour améliorer la vieille race de moutons solognots, un magnifique élevage de moutons mérinos, dont la laine particulièrement fine était recherchée.
La fabrique d'Olivet qui a continué son activité pendant la Révolution a fermé ses portes en 1820.
Une activité industrielle traditionnelle riche et diversifiée : les Moulins sur le Loiret
Ce sont les moines de l’abbaye de Micy qui ont créé les premiers moulins sur le Loiret. On sait que, dès la fondation du monastère à l’aube du 6 esiècle, les moines avaient établi deux moulins sur le Loiret pour moudre le grain des céréales qu’ils cultivaient. C’était alors des moulins « flottants », c’est-à-dire installés sur deux grands bateaux amarrés sur le Loiret, près du monastère. Ces deux moulins s’appelaient Dromedan.
Dans la deuxième moitié du 9 e siècle les raids des Normands remontant la Loire ruinent l’abbaye et les moulins sont abandonnés. Avec la paix revenue, au début du 10 e siècle, les Bénédictins relèvent des ruines leur abbaye. Les premiers Capétiens, très présents dans leur fief Orléanais, leur concèdent des portions de rives qui faisaient partie du domaine royal, sur lesquels les moines vont aménager des chaussées et créer des moulins. Sans doute les tout premiers furent-ils ceux des Tacreniers et de Saint-Santin. Les moines de Micy contrôlaient ainsi la rivière depuis le pont d’Olivet jusqu’à Saint-Samson et depuis le moulin du Bac jusqu’à l’embouchure. On les voit encore s’étendre au tout début du 14 e siècle, époque où ils achètent la source du Loiret au chapitre de la cathédrale d’Orléans, avec le petit moulin de la Source.
Au début du 12 e siècle, une autre communauté religieuse devient propriétaire de moulins sur le Loiret : le prieuré de Saint-Samson, que Louis VII confia aux chanoines du Mont-de-Sion auxquels il donna un groupe de plusieurs moulins qu’on allait appeler Saint-Samson. Les Jésuites rachetèrent le prieuré à la fin du 17 e siècle et devinrent les propriétaires des moulins et des terres autour.
Enfin une troisième communauté religieuse de moniales, le prieuré orléanais de la Madeleine, qui possédait le petit oratoire de Saint-Julien depuis le 12 e siècle y fait construire après le siège d’Orléans en 1429 le moulin à deux roues appelé Saint-Julien. Un peu plus tard les religieuses achètent le moulin des Béchets et les terres qui l’entourent, et en 1465 le moulin de la Mothe. Puis à partir de la fin du XVe siècle, la toute-puissance de l’abbaye de Micy recule, tandis que les bourgeois négociants fabricants d’Orléans commencent à s’intéresser aux moulins du Loiret à des fins « industrielles » : la mouture des grains cesse d’être l’activité exclusive des moulins.
En 1560, dix-sept moulins s'élevaient sur les rives du Loiret : trois, sur la chaussée des Tacreniers, broyaient l'écorce de chêne pour en tirer la poudre de tanin utilisée dans le tannage des cuirs et peaux (moulins à tan). Sur la chaussée Saint-Santin, cinq autres foulaient le drap pour en resserrer et enchevêtrer les fibres pour donner au tissu de l’épaisseur (moulins à foulon). Le moulin du pont d'Olivet, de Saint-Samson et ceux installés près de La Fontaine broyaient le blé (moulins à farine).
Après les guerres de Religion et les troubles de la Ligue (qui endommagèrent de nombreux moulins qui avaient été occupés par une garnison), l’abbaye de Micy totalement ruinée fut obligée de vendre ou de louer à long terme certains de ses moulins qui allaient être exploités par des entrepreneurs orléanais pour des usages industriels : on voit apparaître, à côté des moulins à farine, dès 1650 un moulin à papier sur la chaussée des Tacreniers, spécialisé dans le papier pour emballer les pains de sucre (cette activité de papeterie allait se poursuivre jusqu’au début du 20 e siècle), puis un moulin à poudre (pour les munitions), 2 moulins à chamois (pour nettoyer, assouplir et fouler les peaux de moutons de Sologne et du Berry). Le moulin du pont d’Olivet est utilisé à partir de 1780 par Jacque de Mainville pour actionner les machines à calandrer les toiles peintes de sa manufacture (gros rouleaux à cylindre pour imprimer les motifs sur la toile). Il y a aussi un moulin « à calottes » (le moulin du Bac), qui fabriquait les gasquets ou bonnets turcs. Toute cette activité faisait des bords du Loiret, avec 19 moulins à eau, une « petite zone industrielle » contrôlée par les grands négociants orléanais. Des Règlements de la rivière régissaient l’emploi des vannes et déversoirs de manière rigoureuse, ce qui n’empêchait pas de nombreux litiges entre les meuniers de l’amont et ceux de l’aval. Ceux de l’aval se plaignaient de ne plus avoir assez d’eau pour faire tourner leurs moulins lorsque ceux de l’amont fermaient leurs vannes.
À la Révolution, les moulins appartenant aux religieux sont vendus comme biens nationaux et acquis par les propriétaires des domaines voisins ou par ceux qui exploitaient les moulins auparavant, avec, au cours du XIXe siècle, un retour en force des moulins à farine, un moulin qui fabriquait de la dentelle.
Mais à partir du milieu du 19 e siècle l’activité des moulins sur le Loiret devient moins florissante : la rivière au débit insuffisant s’envasait peu à peu et ne fournissait plus la force motrice nécessaire pour actionner les roues (le captage par la ville d’Orléans d’un volume d’eau toujours plus important avait largement contribué à ce phénomène d’envasement). Les meuniers les plus fortunés équipent alors leur moulin de machine à vapeur ; en 1900 la plupart des moulins du Loiret en sont dotés. Mais les meuniers connaissent de plus en plus de difficultés : ils se sont endettés pour moderniser leurs moulins, remplacer les meules par des cylindres. La guerre de 14-18 va profondément désorganiser la production et seulement quelques moulins reprennent de l’activité après la guerre. Mais peu puissants, mal desservis, ils vont tous être progressivement abandonnés.
Le Moulin à vapeur d’Olivet au milieu du 19 e siècle
En août 1853 Thomas-Nicolas Proust, qui habitait au Petit-Plessis à Saint-Jean-le-Blanc, veut se lancer dans la minoterie et achète à un ancien marchand de vins de grands bâtiments dans la montée du bourg juste après le pont. C’étaient d’anciennes dépendances du château de Plissay, une annexe de l’étable au lieu-dit La Corne de Cerf (on y logeait le bétail de Plissay lors des crues de la Loire et du Loiret). Le nouveau propriétaire, voulant utiliser une puissante machine à vapeur pour faire mouvoir plusieurs paires de meules, fait rehausser les bâtiments d’un étage, construire un local pour la machine à vapeur et élever une grande cheminée. Le moulin commence à fonctionner en 1855 avec 6 paires de meules. Thomas-Nicolas Proust a vu grand : il a même créé une société par actions ayant pour objet la fabrication de la farine par la vapeur, la panification par les appareils brevetés de Rolland, la vente du pain à prix réduit. Mais les affaires démarrent mal (coût de transport trop élevé pour acheminer le charbon), et deux ans plus tard le Moulin à vapeur est en vente, racheté par Louis Lemoine qui y installe une filature de laine. Mais les résultats ne sont pas à la hauteur de ses espérances et Louis Lemoine meurt jeune en 1862. Dès lors ce vaste ensemble de bâtiments, qu’on appelait « La Cour de la Vapeur » va souvent changer de mains, abriter de nombreux locataires, puis tomber en déshérence jusqu’à son rachat par la Ville d’Olivet qui le restaure pour y loger la Maison des Jeunes et de la Culture depuis 1987, sous le nom de « Moulin de la Vapeur ».
Quelques autres industries traditionnelles
La bonneterie
À la fin du 18 e et au début du 19 e siècle, la grosse bonneterie orléanaise Benoist utilisait le moulin du Bac comme moulin à foulon : Jacques-Nicolas et Guillaume-Alexandre Benoist, les fils de Benoist Héry fondateur de cette manufacture royale de bonneterie qui employait 800 personnes, louèrent en 1785 aux moines de Micy le moulin du Bac pour y fouler la laine des « bonnets façon de Tunis » ou « gasquets » qu’ils fabriquaient. Le moulin a servi à ce travail de la laine jusqu’en 1818.
Une fabrique de bonneterie sans couture au 19 e siècle
Installée à Olivet dès le début du 19 e siècle, la Bonneterie Carlier et Cie, à laquelle avait succédé la maison Bouchet et Cie, fabriquait tricots de coton, bas, chaussettes, culottes pour militaires et bonnets sans couture. C’était une usine importante, qui avait un magasin de vente à Troyes, grande place du commerce textile en France. D’après les résultats du recensement de 1841, c’était la plus grosse fabrique d’Olivet, employant 400 ouvriers. Elle a été en activité jusqu’à la fin des années 1870.
Fours à chaux et chaufourniers
Le chaufournier est, dans la production de la chaux vive, l'ouvrier conducteur du four à chaux. Par extension, il désigne l'exploitant d'un four à chaux. Dans le langage des mines et carrières, chaufournier désigne aussi l'exploitant industriel d'une entreprise de production de chaux.
Il y a eu à Olivet plusieurs fours à chaux, qui représentaient une part importante de l’activité industrielle du bourg. Ainsi pour la seule année 1850, l’Annuaire du Commerce et de l’Industrie indique-t-il 4 exploitants de fours à chaux : Bié, Bréviande, Gouspillat, Givot.
Dans les délibérations du conseil municipal d’Olivet, sont évoquées à maintes reprises les nuisances provoquées par ces fours à chaux. Par exemple 1848, une commission municipale demande aux sieurs Lepage-Boubault et Bréviande-Vié, chaufourniers, de faire des réparations à leurs établissements jugés insalubres. En 1866, deux fours à chaux et une fabrique de poudrette établis sur la commune sont déclarés « établissements dangereux et insalubres. » Au conseil municipal du 13 août 1876, les habitants voisins de l’usine du four à chaux de M. Bié se plaignent d’être incommodés par les fumées, les cheminées de cette usine n’étant pas assez élevées. L’administration municipale est chargée de s’occuper de cette affaire.
Enfin, Olivet s’était fait, tout au long du 19 e siècle, une spécialité d’une industrie traditionnelle : la fabrique de balais de bruyères (les brémailles de la Sologne toute proche). Cette activité avait de nombreux débouchés (balais de rues, d’écuries…) La plus importante fabrique de balais d’Olivet était, à la fin du 19 e siècle, la maison Jourdan.